(Dé)divorce
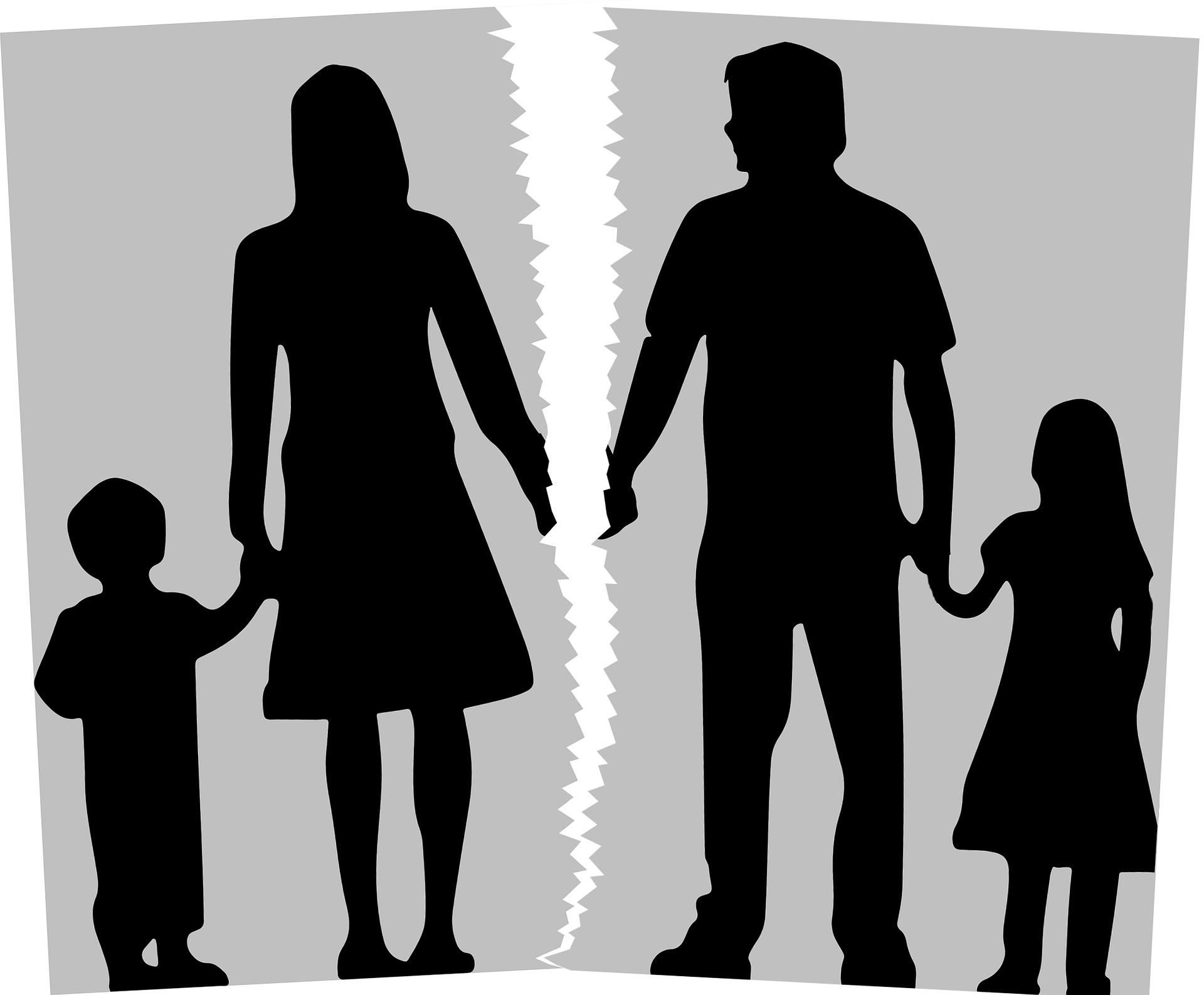
changement d’état civil, conséquences sur la santé, réorganisation de la famille, clarification des contributions d’entretien ou adaptations professionnelles -.
D’une part, les conséquences d’un divorce sont vécues de manière très individuelle. D’autre part, ce qui lie toutes les parties, c’est le fait que les circonstances de la vie changent.
Selon l’étude Demos 1/2020 de l’OFS sur le divorce, le nombre de divorces en Suisse est en baisse depuis 2010. Les personnes divorcées cohabitent aujourd’hui dans divers types de ménages et l’image selon laquelle les divorcés vivent nécessairement seuls est dépassée. L’étude a montré que les personnes divorcées qui vivent avec un partenaire ont par exemple de meilleures conditions de vie et un réseau social plus étendu, ce qui favorise les comportements bénéfiques pour la santé. Après la séparation ou le divorce, la règle depuis 2014 est l’entrée en vigueur de l’autorité parentale conjointe. Lorsque des couples avec enfants se séparent, l’un des parents est généralement tenu de verser une pension alimentaire.
Bien que le nombre de divorces soit en baisse, on estime que deux mariages sur cinq peuvent un jour se terminer par un divorce. En proportion, il y a plus de mariages qui se terminent par le décès du partenaire que par le divorce. On constate une augmentation des divorces chez les personnes mariées depuis 20 à 30 ans. De même, de moins en moins de divorces concernent des enfants mineurs. Cependant, les conséquences financières, sociales et émotionnelles demeurent. On observe une inégalité entre les sexes en ce qui concerne les remariages après un divorce. Les hommes divorcés se remarient plus souvent que les femmes divorcées.
Fin 2018, 723 300 personnes de la population résidante permanente suisse étaient divorcées. La proportion de divorcés a doublé au cours des 30 dernières années, passant de 4,2 % (1988) à 8,5 % (2018). La population divorcée a connu une croissance proportionnellement et numériquement plus importante que la population célibataire, veuve ou mariée.
La pluralisation des modes de vie concerne surtout les personnes d’âge jeune et moyen. Toutes les personnes divorcées ne vivent pas nécessairement seules. Un peu moins de la moitié des personnes divorcées (48 %) vivaient seules en 2017. Chez les hommes, cette proportion était supérieure de 8 points de pourcentage à celle des femmes (53 % contre 45 % ). Comme on pouvait s’y attendre, la proportion de personnes vivant seules augmente avec l’âge.
Le divorce a un impact extraordinaire sur la santé. Différentes études le confirment, tout comme le fait que la vie de couple est bénéfique pour la santé. Il est prouvé qu’il existe un lien entre l’état civil et les séparations/divorces et les maladies, les handicaps et les décès. A quelques exceptions près, les résultats présentés montrent que les personnes divorcées qui vivent sans partenaire sont en moins bonne santé que celles qui vivent en couple, ce qui confirme les bénéfices pour la santé de la vie commune. Le fait d’être divorcé et sans partenaire peut entraîner un sentiment de solitude, la solitude décrivant le manque subjectif de besoins sociaux. Souvent, d’autres aspects tels que le manque de soutien social et de personnes de confiance s’y ajoutent, ce qui favorise encore plus la mise en danger de la santé. Selon l’étude, ce groupe cible a également plus souvent recours aux médicaments. En revanche, aucun effet n’a pu être démontré sur d’autres comportements (alimentation, activité, consommation de tabac).
Souvent, les partenaires ne sont pas les seuls concernés, les enfants sont également impliqués. Si les enfants sont encore mineurs, la question de l’attribution de l’autorité parentale et du lieu de résidence des enfants se pose. Plus d’une personne sur dix (13%) ayant au moins un enfant de moins de 18 ans ne vit plus avec l’autre parent. En cas de séparation ou de divorce, l’autorité parentale est généralement confiée aux deux parents. 61 % des parents séparés ou divorcés ont l’autorité parentale conjointe. Dans neuf cas sur dix, l’autorité parentale est attribuée à la mère. L’autorité parentale conjointe augmente avec l’âge des enfants.
Dans les couples avec enfants, l’un des parents est souvent tenu de verser une pension alimentaire. Un point qui, selon les études, augmente le risque de pauvreté. Les ménages qui reçoivent une pension alimentaire représentent 3,7 % de la population. La majorité d’entre eux (59 %) vivent dans des ménages monoparentaux avec des enfants de moins de 25 ans. Une séparation entraîne généralement une augmentation du coût de la vie. Le montant de la pension alimentaire est fixé non seulement en fonction des besoins de la partie qui a droit à l’aide, mais aussi en fonction des possibilités financières de la partie qui doit l’apporter. Si celle-ci vit au niveau ou en dessous du minimum vital, elle ne doit en principe pas payer de pension alimentaire. Un éventuel déficit doit alors être supporté par le ménage bénéficiaire de l’aide. Une situation de détresse financière est donc tout à fait possible dans ces circonstances.
Les ménages qui reçoivent et versent des pensions alimentaires ne se distinguent pas seulement par leurs revenus, mais aussi par leurs dépenses. Les ménages monoparentaux avec enfants qui reçoivent une pension alimentaire consacrent près d’un tiers de leur revenu brut aux postes de dépenses logement, alimentation et habillement. 10 % du budget sont consacrés aux communications et aux transports et 7 % aux loisirs et à la culture. Les autres dépenses de consommation représentent 18 %. Pour les individus qui paient une pension alimentaire, les parts consacrées au logement et aux dépenses de consommation sont proportionnellement plus faibles.
En conséquence, la nouvelle situation a souvent des répercussions sur la situation professionnelle : adaptation du taux d’occupation, modification des conditions de travail. Selon l’étude, les femmes divorcées âgées de 25 à 64 ans ont un taux de participation au marché du travail plus élevé que les femmes mariées du même âge. En 2018, 80,3 % des femmes divorcées avaient un emploi, contre 73,9 % des femmes mariées. En plus d’une participation plus élevée au marché du travail, les femmes divorcées sont touchées par un taux de chômage plus élevé que les femmes mariées. Sur la période 2016-2018, le taux de chômage au sens du BIT des femmes divorcées était de 5,5 %, contre 4,9 % pour les femmes mariées. Pour les hommes, ces taux étaient respectivement de 5,6% et 3,6%.
More Articles
FORT·ES · ET CONFIANT·ES · élever seul·e.
28. septembre 2025
Pour la 7e Journée internationale des parents mono Le 28 septembre, il y a sept ans, une mère élevant seule son enfant a créé la…
Le temps passé en famille – parce que le travail de care concerne tout le monde
25. mai 2025
Le 2 avril, l'initiative « Temps pour la famille » a été lancée, soutenue par une large alliance. Son objectif : permettre aux parents de partager plus équitablement le travail rémunéré et le travail de care non rémunéré. Car cela nécessite de nouvelles structures - et ce dès le début, c'est-à-dire dès la naissance d'un enfant.
Comment tout a commencé : Ma propre histoire d’aliénation
24. mars 2024
En cette année 2024 qui marque notre anniversaire, nous lançons une nouvelle série de blogs intitulée « Expériences de parents uniques », dans laquelle nous partageons…




